
Une musique résistante
Entretien réalisé avec Éric Denut
Vous avez affirmé : « dans la totalité des œuvres que l’on écrit, il est certain que tout ne vient pas de vous ». Plus loin dans le même entretien, on lit cette phrase : « la cohérence pour moi, ce serait de parvenir à s’emparer de matériaux hétérogènes ». Dans un autre entretien enfin, vous expliquez : « Je suis passé par le filtre d’autres musiques et j’ai donc subi leur influence » et vous citez le jazz dont vous avez besoin pour vous « ressourcer ». D’autre part dans des œuvres comme Kits (1996), Pour Luigi (1994), Variations (2000), on retrouve sans peine des cellules rythmiques qui font référence au jazz et au funk. Pourriez-vous nous préciser les tenants et aboutissants de ce parcours dans lequel certaines musiques actuelles semblent jouer un rôle important ?
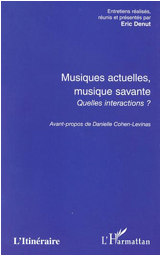 J’ai commencé mon éducation musicale par la musique classique, dans le cadre d’un cursus normal d’un enfant de province. Puis j’ai écouté du rock et dévié très rapidement vers le jazz rock (Weather Report, etc.) Je reste toujours admiratif de Jimmy Hendrix. À l’époque, la musique écrite me frustrait. Je me suis offert une première guitare, et j’ai joué dans des groupes semi-professionnels non seulement de la guitare mais aussi du violon. Au même moment, comme je commençais à écrire de la musique, je me suis retrouvé à écrire des thèmes pour des gens qui jouaient mieux que moi. C’était semi-professionnel, mais il y a maintenant parmi eux des musiciens qui jouent du jazz professionnellement, alors que j’ai abandonné en cours de route. Mais j’écoute toujours beaucoup de jazz, j’improvise au piano pour le plaisir et je crois que j’ai attrapé à jamais le groove, car quand on l’a, on vit et on meurt avec.
J’ai commencé mon éducation musicale par la musique classique, dans le cadre d’un cursus normal d’un enfant de province. Puis j’ai écouté du rock et dévié très rapidement vers le jazz rock (Weather Report, etc.) Je reste toujours admiratif de Jimmy Hendrix. À l’époque, la musique écrite me frustrait. Je me suis offert une première guitare, et j’ai joué dans des groupes semi-professionnels non seulement de la guitare mais aussi du violon. Au même moment, comme je commençais à écrire de la musique, je me suis retrouvé à écrire des thèmes pour des gens qui jouaient mieux que moi. C’était semi-professionnel, mais il y a maintenant parmi eux des musiciens qui jouent du jazz professionnellement, alors que j’ai abandonné en cours de route. Mais j’écoute toujours beaucoup de jazz, j’improvise au piano pour le plaisir et je crois que j’ai attrapé à jamais le groove, car quand on l’a, on vit et on meurt avec.
Peu à peu, je suis entré dans l’écriture savante contemporaine et j’ai complètement oblitéré cette partie de ma vie. Il y avait peu de rythme dans ma musique à l’époque où j’ai commencé à composer sérieusement ; quand on parlait du rythme, il s’agissait plutôt de traitement des durées ou au mieux, d’organisation de flux. Dans les années 1993/94, je me suis retrouvé en contact avec des amis qui avaient participé à ma formation jazzistique. J’ai alors écouté à nouveau beaucoup de jazz. Dès 1991, avec les Six miniatures, j’ai commencé à utiliser certains éléments musicaux que j’avais jusque-là laissés de côté. Kits est un peu à part : il s’agit d’une commande pour un spectacle qui comprenait des pièces de Carla Bley, Frank Zappa et Martial Solal. Il n’empêche que c’est une pièce très sérieuse à maints égards.
Si l’influence du jazz s’est fait sentir sur le plan du rythme et du phrasé, il n’en est rien au plan harmonique où je reste fidèle à une influence spectrale mais sans dogmatisme. Je me suis rendu compte que dans des petites phrases qu’on n’entend pas toujours ailleurs, mais qui font partie des mixtures que j’organise, je n’arrivais pas à penser autrement qu’avec un certain type de groove. Je pense la plus petite valeur, ce que ne font pas les musiciens classiques : il y a là un apport évident de la musique beat (rock, jazz, jazz-rock, funk, etc.) Bien sûr, je n’en fais pas un étendard. Les jazzmen, lorsqu’ils écoutent ma musique n’y comprennent souvent rien, même s’ils remarquent immédiatement le groove.
Dans les pièces les plus récentes, comme les Variations pour percussion et ensemble, on est harmoniquement très éloigné du jazz. Sur le plan formel c’est la même chose, mais il reste toujours un groove sous-jacent, notamment dans certaines phrases jouées par le vibraphone. Dans Pour Luigi, le motif initial provient de l’écoute d’éléments d’accompagnement de guitare que l’on trouve dans la musique funk ou rythme and blues. Ce motif est harmonisé de manière totalement hétérogène : le premier accord est néo-stravinskien, le second une modulation de fréquences. Ensuite, ces accords sont transformés à l’aide de l’ordinateur au même titre que le motif rythmique de départ. La présence d’un modèle étranger est donc de l’ordre de l’intime. L’influence du jazz chez moi est d’abord liée à l’énergie, et dans un deuxième temps seulement, à l’écriture, non pas sur le plan mélodique, mais sur le plan de l’énergie rythmique, et, enfin, au choix des instruments. Ce n’est bien entendu pas un hasard si je me suis beaucoup tourné vers des pièces pour percussion. Je trouve les concertos contemporains assez ennuyeux car trop chargés de pathos romantique ; naturellement je me suis porté vers la famille d’instruments qui n’exprime rien, ou alors une forme de groove revisité. Un instrument comme le vibraphone que j’utilise largement dans les Variations, est assez pauvre au niveau du timbre, mais possède des possibilités rythmiques, d’abord parce qu’il est un instrument percussif mais aussi et surtout parce qu’il est joué par des instrumentistes souvent très au fait des techniques jazz.
L’influence du jazz la plus pertinente dans mon travail, c’est cependant l’homorythmie. C’est un principe que je laisse de plus en plus tomber aujourd’hui, car c’était devenu un piège. Messiaen détestait le jazz, mais pour beaucoup de jazzmen Messiaen fait partie des rares compositeurs contemporains qui restent digérables. Pour ma part, plus je m’intéresse au jazz, plus je reviens vers Messiaen. Chez lui l’homorythmie et l’écriture parallèle ne sont pas sans rappeler l’écriture pour big band. Pour Luigi fonctionne avant tout sur une homorythmie non perturbée par le croisement des voix. Cela pose beaucoup de problèmes rythmiques et oblige les musiciens à une concentration maximale car ils doivent jouer des rythmes beaucoup plus compliqués que ceux du jazz sans que rien ne bouge jamais sur le plan vertical. Travaillant régulièrement avec un ensemble, je me suis rendu compte que cette écriture était une forme de pédagogie formidable pour des musiciens habitués à jouer des polyrythmies complexes sans pulsation perceptible. Maintenant, l’Ensemble Court-circuit sait jouer en place, même dans des pièces très ardues. Au début, l’homorythmie a été pour moi une espèce de pulsion réactionnelle. Notre génération a été privée de rythme, de pulsation, d'ostinato ; dans la musique spectrale, on pensait flux, avec l’idée que le rythme n’était que la conséquence du timbre. Dans la musique savante, et surtout depuis le XIXème siècle, le rythme a été longtemps assimilé à la facilité et à la vulgarité. On ne peut plus prendre aujourd’hui ce retour au rythme dans la musique contemporaine comme une simple réaction, bien que le danger soit toujours présent de tomber dans le néoclassicisme en utilisant des rythmes connotés et éculés. Mais à partir du moment où l’on travaille sur le rythme de manière moins épidermique, ce qui était nécessaire dans la phase de réaction, et plus réfléchie, le danger est écarté. Le rythme reste un enjeu majeur dans la musique d’aujourd’hui.
Ainsi, je me suis remis à écrire beaucoup de contrepoint et à sortir de l’impasse de la seule écriture homorythmique pour me tourner vers des polyphonies plus complexes qui ont à voir avec les musiques extra-européennes.
Pour en revenir au jazz, plus que jamais, je me sens bien avec les instrumentistes car ils ont souvent la double culture jazz et classique. Le rock et le jazz nous ont permis de penser le rythme autrement et de sortir de l’éducation occidentale du rythme totalement obsolète et inefficace à mon sens.
Vous vous souciez énormément de la perception des structures que vous écrivez. Toutefois vous affirmez que l'écriture « intuitive », sans calcul préalable, ne permet pas d’atteindre des zones inexploitées de la musique : « Je préfère entendre ce que j’écris, qu’écrire ce que j’entends ». Vous cherchez à concilier perception aisée et multiplicité des niveaux de lecture. Cette ambiguïté, un terme que vous défendez, n’est-ce pas ce qui vous rattache et vous sépare à la fois de certaines formes de musiques actuelles moins concernées par la recherche ?
Si on écrit ce qu’on entend, on écrit ce qui a déjà existé. Cette affirmation peut paraître contradictoire avec les influences qui me viennent du jazz. Mais il faut voir que les musiques actuelles ont également évolué depuis les Beatles. Entre le blues des débuts et Weather Report ou Michael Brecker, il y a une évolution : Brecker ou Steve Coleman entendent ce qu’ils jouent et ne jouent pas simplement ce qu’ils entendent. Les process de chorus out sont même enseignés dans les écoles de jazz américaines. Ce qui a pour conséquence que le jazz tend à devenir une musique savante, même s’il se fonde sur des bases harmoniques mortes : le bon jazzman sera celui qui transgresse les codes, comme ça a été le cas dans la musique savante. La différence aujourd’hui avec la musique savante est que cette dernière n’a plus de code, en tout cas pas de code fort. Elle se fonde sur des philosophies, des comportements, plus que des codes. Comprendre chaque compositeur nécessite un travail d’approche spécifique même si l’on remarque un certain nombre d’invariants dans la musique d’aujourd’hui.
Quand je commence une pièce, j’ai l’impression, comme beaucoup de compositeurs, que je ne sais rien. Peut-être est-ce d’ailleurs un tort de la musique savante de ne pas avoir su créer un consensus suffisamment fort (quoiqu’en pensent les journalistes toujours à la recherche d’un compositeur iconoclaste de la génération spontanée). Or il faudrait voir dans les tentatives de la part des compositeurs de s’unir autour d’idées communes non pas un manque de personnalité, mais une philosophie partagée.
Il y a un moment cependant où l’on se pose la question : si composer pendant longtemps n’amène pas certains réflexes, un acquis, il faut arrêter. N’importe quel artisan possède cet acquis ; à lui après d’être créatif à chaque œuvre. Maintenant je laisse volontiers entrer une part de connu dans mon écriture, mais j’ai l’impression que ce qui est déjà connu m’est vraiment personnel.
Vous accordez une grande importance à la reconnaissance d’éléments variés, aux signaux et aux répétitions (par exemple dans Fragment de Lune pour quinze instruments et dispositif électronique). Une de vos œuvres s’appelle Flash-back (pour orchestre 1998) ; à propos de Mémoire vive (pour orchestre, 1998), vous parlez même de « leitmotivs ». Y a-t-il dans ces éléments des invariants au niveau formel auxquels vous tenez ?
Intuitivement, les musiques populaires et jazz ne sont pas étrangères à l’idée de répétition dans mon écriture. Mais je me suis aperçu que, biologiquement, il était nécessaire de répéter pour qu’un début soit un début et une fin une fin. Dans certaines de mes œuvres, il y a des réexpositions variées un peu partout, et parfois on se rapproche de formes ABA. Dans mes dernières œuvres, il est impossible de comprendre la forme au premier abord. Mais il est vrai qu’à une certaine époque j’ai voulu complètement assumer la répétition.
Dans les Variations, la fin consiste en une certaine distribution du matériau. Même s’il est difficile de s’en apercevoir à la première écoute, quand on arrive à la fin de la pièce, on a fait un parcours en arrière de certaines sections. Des situations musicales entières sont reprises, mais superposées à d’autres par exemple.
À la première écoute, on sent que tous ces éléments font partie d’un même monde, c’est tout. Pourquoi faire ça ? Non par souci de complexité ni de simplicité d’ailleurs. Je crois qu’à la perception d’une œuvre, on est sensible à une première lecture relativement architecturée. Après cette lecture, il peut y avoir des couches très complexes. Mais je suis sensible à l’idée de donner la clé à l’auditeur de la lecture d’une pièce. La question est : jusqu’où peut-on aller dans la déformation ? L’influence des musiciens spectraux a certainement pour conséquence que je reste attaché à ce qu’on puisse comprendre la forme et les opérations misent en œuvre.
Indépendamment de votre propre création, y a-t-il selon vous des interactions entre la musique savante et les musiques actuelles ? Les influences vont-elles dans les deux sens ?
Je trouve formidable que la techno se revendique de Pierre Henry, tout comme le jazz se revendiquait de Ravel et Debussy. Cela prouve qu’ils ont trente-cinq ou quarante ans de retard. Toutes les musiques populaires commerciales ont toujours un « retard à l’allumage ». Elles devraient plutôt revendiquer Ligeti ou Grisey, c’est plus récent. En tout cas, ça prouve que Pierre Henry n’a pas travaillé en vain.
En ce qui concerne la politique du Ministère, je ne comprends pas qu’on puisse subventionner une musique à laquelle on a de toute manière donnée d’ores et déjà tout le pouvoir : télévisions, radios. Donner les moyens de s’exprimer médiatiquement est peut-être plus important aujourd’hui que de donner des subventions, indispensables au demeurant. La seule chose que devrait faire l’État est de soutenir la musique résistante, la nôtre. Si l’on veut que dans quelque temps il y ait un nouveau Pierre Henry pour influencer les musiques populaires, il faut être logique avec soi-même.
Ce qui est en outre pour le moins agaçant, c’est que nous recevons des leçons de la part de gens qui ne comprennent rien aux musiques commerciales actuelles alors que, dans mon cas comme celui d’autres compositeurs, nous les avons pratiquées, les connaissons de l’intérieur et les prenons pour ce qu’elles sont : un divertissement. La vision de l’État est souvent prisonnière d’une mauvaise compréhension de la modernité. Dans trois accords de Grisey, il y a plus de modernité que dans quarante kilos d’électronique. La modernité n’est pas une affaire de kilomètres de câbles. Il suffit d’écouter les musiques électroniques actuelles qui passent à la télévision.
Je pense qu’on est dans une époque de marchandage culturel, entre les États-Unis et une Europe qui a du mal à se faire. Les hommes d’États européens ont compris que la musique doit se vendre comme une marchandise quelconque. Ils la traitent ainsi. Mais c’est mépriser le public. En voulant tout réglementer, d’une part, on crée une espèce de racisme radiophonique et télévisuel car on ne défend que les musiques soi-disant « jeunes », d’autre part on retire à des musiques de contestation sociale comme le rap, toute crédibilité, dès lors qu’on lui donne officiellement les moyens de s’exprimer. Aujourd’hui le rap français s’endort, ses musiciens sont repus.
La position très ambiguë de l’État envers la musique contemporaine est donc de donner d’un côté pour reprendre de l’autre. Tout se passe comme si l’État avait honte de ce qu’il subventionne. Dans les premières chartes de la DMDTS, la musique contemporaine ne faisait partie d’aucun chapitre. L’effort de l’État aujourd’hui, c’est l’opéra, les orchestres et les musiques actuelles. La création musicale est le parent pauvre, mis à part quelques institutions pérennes.
La musique contemporaine ne doit-elle pas également balayer devant sa porte ?
Dans certains domaines, certainement, mais ce n’est pas si simple. La production de disques de musique contemporaine par exemple n’est pas comparable avec celles des musiques actuelles commerciales : quatre jours de mix d’un côté contre six mois de studio de l’autre. Pourtant on a fait des efforts : désormais, on utilise le studio et les bandes de concert remastérisées ont peu à peu disparu. Mais trop peu de compositeurs ont appris ce qu’il fallait apprendre des musiques commerciales : la qualité professionnelle des produits (un mot dangereux…). Le problème est que, dans le domaine de la musique savante, la machine économique reste pauvre ; on ne peut pas investir puisqu’on ne vendra pas. Car pour vendre, il faudrait médiatiser. Mais pour médiatiser il faudrait investir, donc on se mord la queue.
Si on veut parler du concert, il faudrait avoir un budget pour prévoir de travailler avec un metteur en scène, un véritable éclairagiste, un créateur de costumes, etc. créer une vraie politique de communication. Mais si l’on commence à entrer dans cette logique, on ne joue plus, faute d’argent. On privilégie donc naturellement le « musical » au détriment de ce qui l’entoure et qui serait très améliorable.
On pourrait toutefois changer immédiatement beaucoup de choses si on supprimait le format de concert avec ses inévitables quatre pièces qui sont trop souvent sans rapport. En voulant être généraliste, on fait une erreur fondamentale, car on empêche le public d’entrer dans un style. On observe la même erreur de jugement sur les ondes de Radio-France : France Musiques au pluriel ne correspond pas à ce que les gens cherchent. Bien au contraire, le public désire maintenant trouver rapidement ce dont il a besoin.
D’ailleurs à ce propos, j’observe un paradoxe important : il est très bien vu qu’un directeur de centre chorégraphique ne présente que sa danse, et il est très mal vu qu’un musicien qui monte son propre ensemble ne propose que sa propre musique. Même en jazz, l’ONJ joue la musique de son chef pendant deux ans… Pour ma part, j’aimerais laisser Court-circuit entre les mains d’un créateur pendant une saison. Si je laisse l’ensemble à un chorégraphe, jamais personne ne dira rien ; si je m’aventure à faire cela avec un compositeur, on me reprochera d’accaparer l’argent public pour un seul artiste et les programmateurs ne suivront pas de toute façon.
Pourra-t-on résoudre les problèmes en intégrant les compositeurs, comme cela se fait avec un certain succès, dans les circuits des orchestres régionaux ? On peut en douter, car d’une part, les ensembles spécialisés restent les meilleurs vecteurs pour la transmission de cette musique, et d’autre part, on n’attire pas forcément un public nouveau avec des institutions vieillissantes et très conservatrices et, une fois de plus, trop généralistes. À moins de modifier complètement la configuration des programmes et de proposer, comme on devrait le faire, une symphonie de Brahms pour trois pièces contemporaines.
Doit-on pour autant être pessimiste sur l’avenir d’un art musical dynamique ?
Les réseaux qu’on crée en Europe sont une grande source d’espoir : festivals, ensemble, etc. D’autre part, j’ai l’impression qu’on est entré de nouveau dans une époque où les artistes s’engagent politiquement. Les arguments du collectif Comp’Act, créés par des compositeurs en 1991 et totalement conspués à l’époque, sont repris aujourd’hui non seulement par les compositeurs qui n’y avaient pas cru, mais aussi par les jazzmen, les cinéastes… et même par certains chanteurs de variété « à texte » écrasés par les musiques de masse. La qualité de notre époque réside malgré le mépris des médias pour l’art savant, dans une nouvelle cohésion : les artistes se retrouvent pour défendre la même cause, la liberté d’expression.
in Musiques actuelles, Musique savante, Quelles interactions (page 29 à 36).
Musique et Musicologie, L'harmattan - ISBN : 2-7475-1451-X • mars 2002 • 114 pages